Pierre Loti, trois regards (en grands caractères) sur la Terre sainte
Posté le 09 / 10 / 2025

Entre 1894 et 1895, Pierre Loti publie trois récits sous forme de triptyque consacrés à la Terre sainte. Ces ouvrages s’inscrivent dans la tradition littéraire des récits de voyage du XIXᵉ siècle, tout en portant l’empreinte singulière de leur auteur. Après avoir saisi l’intemporalité et la virginité du Sinaï (Le Désert), il observe minutieusement églises et pèlerins dans Jérusalem, avant de peindre des paysages en mots, les Évangiles à la main tel un guide (La Galilée).
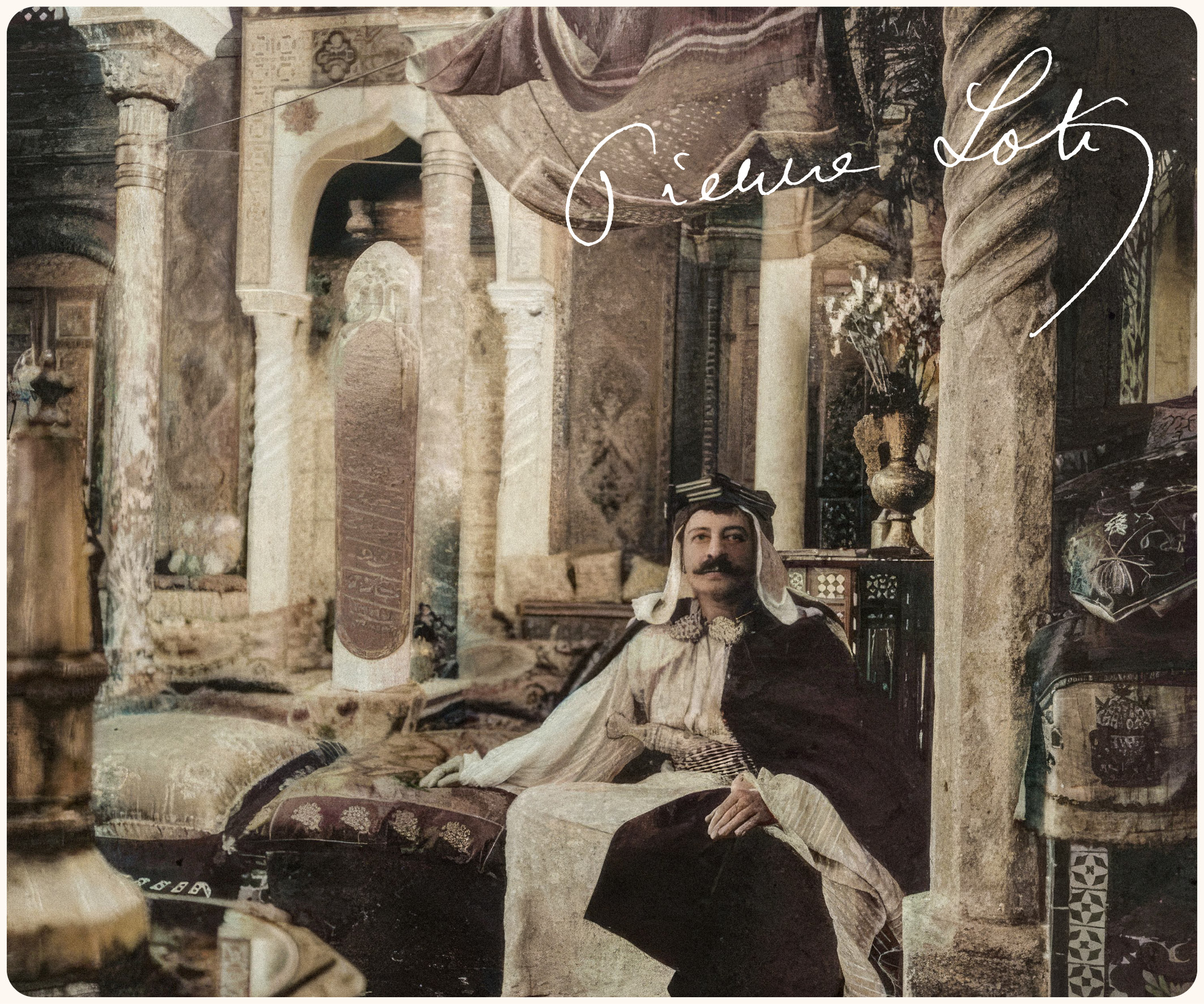
Le Désert
Pierre Loti, romancier à succès et mondain assumé, fut l’un des écrivains les plus lus de son époque. C’est pourtant ce même homme qui, délaissant les honneurs, choisit de se perdre dans les solitudes d’un désert et d’y partager la vie ascétique des hommes. Le 22 février 1894, il quitte l’oasis de Moïse, accompagné de quelques amis, d’un interprète et de chameliers. Après une halte de quelques jours au monastère Sainte-Catherine, la caravane entreprend un long chemin à travers le Sinaï, où, dans cette immensité aride, foisonnent des couleurs subtiles au gré des lumières changeantes, de l’aube à la nuit.
Le Désert est le récit captivant d’un homme en quête de lui-même, entre mirages et réalités, sur les traces de Moïse, jusqu’à Jérusalem, où la fin du voyage se confond avec la fin d’un rêve.
* * *
« Où sont mes frères de rêve, ceux qui jadis ont bien voulu me suivre aux champs d’asphodèles du Moghreb sombre, aux plaines du Maroc ?… Que ceux-là, mais ceux-là seuls, viennent avec moi en Arabie Pétrée, dans le profond désert sonore.
Et que, par avance, ils sachent bien qu’il n’y aura dans ce livre ni terribles aventures, ni chasses extraordinaires, ni découvertes, ni dangers ; non, rien que la fantaisie d’une lente promenade, au pas des chameaux berceurs, dans l’infini du désert rose…
Puis, au bout de la route longue, troublée de mirages, Jérusalem apparaîtra, ou du moins sa grande ombre, et alors peut-être, ô mes frères de rêve, de doute et d’angoisse, nous prosternerons-nous ensemble, là, dans la poussière, devant d’ineffables fantômes. »
* * *
Jérusalem
Pierre Loti, écrivain agnostique, n’a jamais renoncé à l’idée de Dieu, et c’est dans l’espoir d’éclairer cette quête spirituelle qu’il franchit les murailles de Jérusalem. Ce séjour, à la fois historique et introspectif, l’amène à saisir l’intemporalité autant que l’effervescence religieuse et mystique de la Ville sainte. S’il confesse ne pas avoir retrouvé la foi qu’il espérait, Jérusalem demeure le vibrant témoignage d’un voyageur captivé par la beauté de ces terres ancestrales et divisées. Avec une précision sensible, il décrit le Saint-Sépulcre, la mosquée d’Omar, le Mur des Lamentations ou encore la vallée de Josaphat, où Orient et Occident, croyants de diverses confessions, cherchent à concilier leurs prières.
Jérusalem, deuxième volet du triptyque, est à la fois un carnet de voyage et une réflexion personnelle, où Loti plonge dans l’atmosphère spirituelle et historique de ces lieux sacrés.
* * *
« Jérusalem !… Oh ! l’éclat mourant de ce nom !… Comme il rayonne encore, du fond des temps et des poussières, tellement que je me sens presque profanateur, en osant le placer là, en tête du récit de mon pèlerinage sans foi !
Jérusalem ! Ceux qui ont passé avant moi sur la terre en ont déjà écrit bien des livres, profonds ou magnifiques. Mais je veux simplement essayer de noter les aspects actuels de sa désolation et de ses ruines ; dire quel est, à notre époque transitoire, le degré d’effacement de sa grande ombre sainte, qu’une génération très prochaine ne verra même plus…
Peut-être dirai-je aussi l’impression d’une âme – la mienne – qui fut parmi les tourmentées de ce siècle finissant. Mais d’autres âmes sont pareilles et pourront me suivre ; nous sommes quelques-uns de l’angoisse sombre d’à présent, quelques-uns d’au bord du trou noir où tout doit tomber et pourrir, qui regardons encore, dans un inappréciable lointain, planer au-dessus de tout l’inadmissible des religions humaines, ce pardon que Jésus avait apporté, cette consolation et ce céleste revoir… Oh ! il n’y a jamais eu que cela ; tout le reste, vide et néant, non seulement chez les pâles philosophes modernes, mais même dans les arcanes de l’Inde millénaire, chez les Sages illuminés et merveilleux des vieux âges… Alors, de notre abîme, continue de monter, vers celui qui jadis s’appelait le Rédempteur, une vague adoration désolée…
Vraiment, mon livre ne pourra être lu et supporté que par ceux qui se meurent d’avoir possédé et perdu l’Espérance Unique ; par ceux qui, à jamais incroyants comme moi, viendraient encore au Saint-Sépulcre avec un cœur plein de prière, des yeux pleins de larmes, et qui, pour un peu, s’y traîneraient à deux genoux… »
* * *
La Galilée
La Galilée constitue le dernier volet du voyage de l’auteur en Terre sainte, quête mystique à la recherche d’une présence spirituelle. De Jérusalem quittée sous la pluie et le froid, il traverse les étendues vides et herbagées de la Galilée, puis le désert, Damas, l’Antiliban et enfin Beyrouth. C’est à la fois un témoignage — les Évangiles à la main tel un guide — sur cette Terre autrefois bénie d’un Dieu et qui ne semble plus parcourue que par quelques tribus bédouines, et l’occasion d’un superbe portrait de Damas, entre les ruines silencieuses de son passé et l’agitation de ses ruelles et de ses souks. Le voyage de Loti met en lumière cette part d’âme que les villes perdent avec (déjà !) l’arrivée massive des touristes européens.
* * *
« J’ai parcouru la triste Galilée au printemps, et l’ai trouvée muette sous un immense linceul de fleurs. Les ondées d’avril y tombaient encore, et elle n’était qu’un désert d’herbages, un monde de graminées légères, prenant vie nouvelle au chant d’innombrables oiseaux. Les grands souvenirs, les débris, les ossements semblaient plus profondément y sommeiller, sous ce silencieux renouveau des plantes, – et j’ai voulu, dans mon récit, les remuer à peine. Aux approches de Nazareth et de la mer de Thibériade, le fantôme ineffable du Christ deux ou trois fois s’est montré, errant, presque insaisissable, sur le tapis infini des lins roses et des pâles marguerites jaunes, – et je l’ai laissé fuir, entre mes mots trop lourds…
Les aspects intimes de la campagne, la couleur, les sons et les parfums, c’est tout ce que j’ai peut-être noté en passant.
Et c’est d’ailleurs, dans ce pays sacré de Gâlil tant de fois décrit par les poètes merveilleux, la seule part que mes aînés m’aient laissée. »

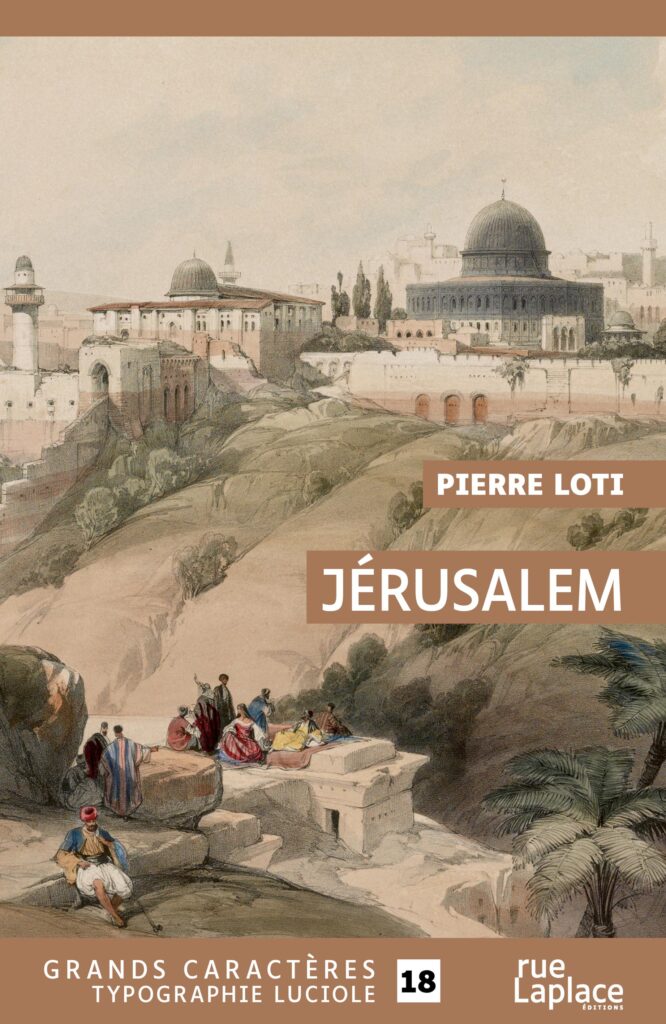
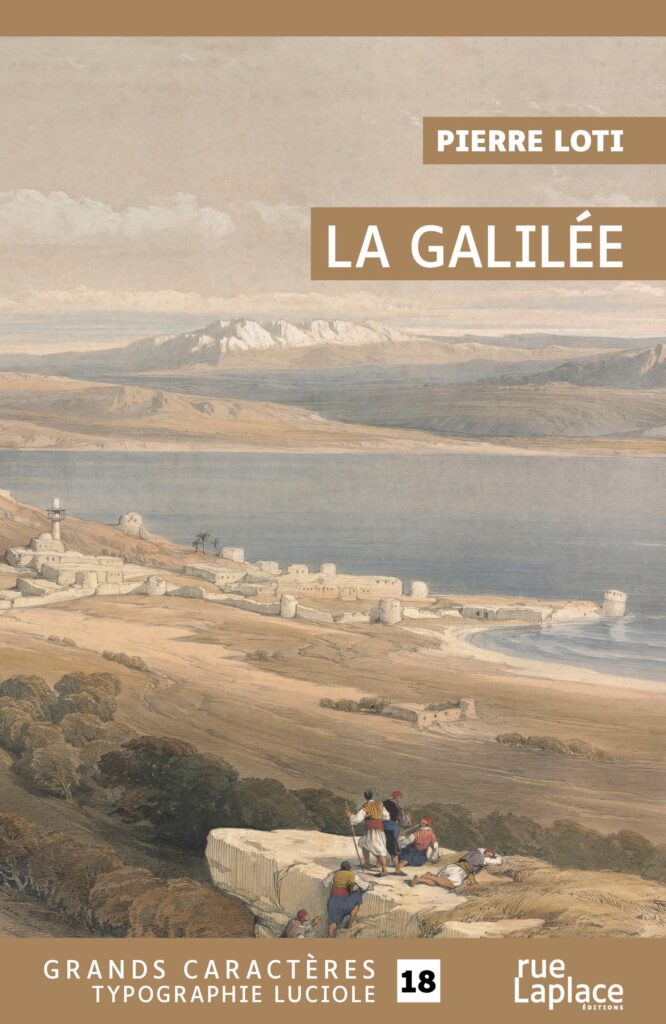
Ces trois récits, rédigés à partir de notes prises sur place, forment véritablement un triptyque : s’ils peuvent se lire séparément, ils constituent ensemble le témoignage d’une quête vouée au désenchantement. Ils illustrent la capacité de Pierre Loti à faire dialoguer l’histoire, la géographie et l’expérience personnelle, tout en conservant une distance lucide. Plus d’un siècle après leur parution, ils demeurent une source précieuse sur la perception occidentale de la Terre sainte à la fin du XIXᵉ siècle.










